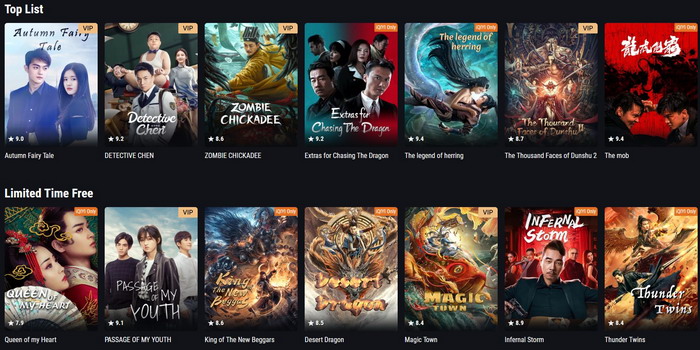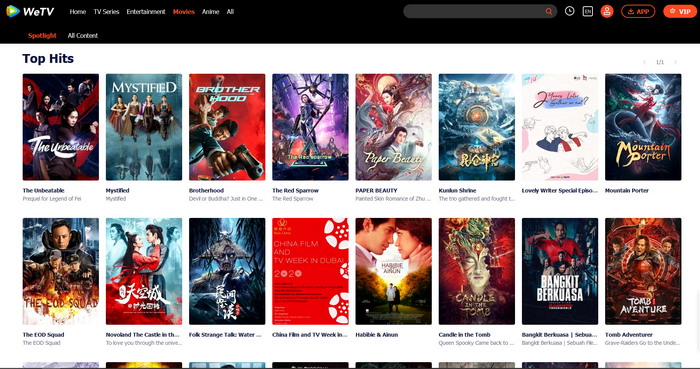Catalogué (à tort ?) comme la quintessence de la pudibonderie cinématographique, le cinéma indien souffre toujours et encore de préjugés tenaces. En effet, même le cinéphile averti et curieux a toujours le réflexe d’assimiler les productions indiennes aux grandes comédies romantiques produites à Bombay. À croire que ce pays qui produit près d’un millier de films par an n’est pas capable de créer du subversif et de titiller les grandes institutions qui décident de ce qui doit être moralement bon ou mauvais aux yeux du spectateur indien. Bien que tous les films aux sujets sociaux et politiques soient décryptés finement par le CBFC (Central Board of Film Certification), ce sont essentiellement les films présentant un caractère sexuel qui subissent l’essentiel des coupes liées à la censure. N’y aurait-il donc pas la place à un cinéma fripon dans cet immense pays marqué par l’omniprésence de grandes religions influentes et conservatrices ? Sans doute que oui, si l’on se contente de mesurer son appréciation par rapport au référentiel occidental submergé quotidiennement par une pornographie de plus en plus omniprésente et agressive. Mais c’est sans compter sur une poignée de réalisateurs qui osent se confronter plus ou moins frontalement à cet interdit.
Bien que l’Inde se place parmi les grands pays producteurs de films, le sexe n’a jamais été un sujet abordé frontalement à l’écran, dans le cinéma populaire. Il est d’autant plus étonnant que le pays est mondialement connu pour ses temples de Khajurâho datant de 950 à 1050. Ces fameux temples présentent des sculptures érotiques qui figurent parmi les représentations pornographiques les plus anciennes connues à ce jour (rappelons tout de même le flou total concernant la signification de ces sculptures). Près d’un millénaire plus tard, l’Inde semble totalement timorée à l’idée de représenter, quel que soit le degré de représentation, la sexualité à l’écran. Les réalisateurs s’autocensurent afin de ne pas froisser le très puissant CBFC qui a le pouvoir de nuire au succès d’un film, et le spectateur de base est encore allergique à la vision d’un simple baiser à l’écran. Le CBFC, à l’instar de nombreux autres pays, a son propre système de classification dont le résultat peut facilement s’observer sur le visa d’exploitation qui est disponible avant le générique de tous les films produits en Inde. Le système de classification se décline en 4 catégories :
U : Universel, concerne les films tout public.
U/A : Unrestricted with Adult Accompaniment, concerne les films présentant un minimum de violence.
S : Special, concerne les films destinés à des catégories sociales précises.
A : Adult only, signe le plus souvent l’arrêt de mort commercial des films.
Le CBFC menace régulièrement de classer les films « A », afin de faire sauter au montage quelques séquences jugées trop permissives. A titre d’exemple, Sanjay Leela Bhansali a été obligé, la mort dans l’âme, de retirer un plan montrant les fesses de Ranbir Kapoor dans Saawariya (2007). En effet, la menace d’un « A » sur son visa d’exploitation aurait bridé toute tentative d’exploitation en salle. Un autre exemple connu pour avoir subi les foudres de la CBFC concerne la poitrine un peu trop dévoilée de Rani Mukherjee dans le très controversé Hey Ram (2000), produit par Kamal Hassan.
En Inde, contrairement à d’autres pays asiatiques, la classification « A » d’un film n’est pas le prétexte à une surenchère et à un sous-genre cinématographique comme a pu l’être la Catégorie 3 à Hong Kong. Les réalisateurs les plus kamikazes flirtent tout juste avec la classification « U/A » dans le but de créer un buzz autour du film (essentiellement les polars et les thrillers violents). Rares sont aujourd’hui les cinéastes à oser le suicide commercial de leurs œuvres et à provoquer le CBFC. Cet état de fait est d’autant plus regrettable que durant les années 80 et au début des années 90, certains réalisateurs se permettaient quelques libertés que l’on ne retrouve plus aujourd’hui. Parmi la fameuse vague Disco des années 80 et ses films ultra sexy (Disco Dancer, Disco Dancer 2, Kasam Paida Karne Wale Ki, etc …), un film comme Janbaaz de Feroz Khan surprend par sa débauche de séquences dont l’acte sexuel est presqu’explicite ainsi que certaines tenues féminines à la limite du string. Les séquences (volontairement ?) homosexuelles du film de Feroz Khan sont, elles aussi, purement hallucinantes. Pour un film datant de 1986, avouez que cela peut en étonner plus d’un ! On se retrouve alors à des années lumières des films post-2000 faussement subversifs que peuvent être, par exemple, Dhoom, Musafir ou encore Kidnap avec leurs lots de bikinis et de séquences tee-shirt mouillé trop clean pour y déceler un minimum de provocation.
D’ailleurs, il est important de souligner l’importance et l’omniprésence de cette fameuse technique du tee-shirt, ou du sari mouillé. Que ce soit les réalisateurs hindis, télugus ou tamouls (bref l’ensemble des cinémas régionaux), le wet saree est sans doute le moyen le plus populaire de représenter l’acte sexuel de manière allégorique à l’écran et de proposer des corps féminins à la limite de la nudité. Cette liberté se retrouve très souvent dans les nombreuses séquences musicales qui parsèment les films indiens, avec de nombreuses analogies liées à l’acte sexuel. Ram Teri Ganga Maili de Raj Kapoor (1985), Barsaat de Rajkumar Santoshi (1995) pour Bollywood ou encore Varsham (2004) et Pelli Sandadi (1997) des réalisateurs télugus Sobhan et K. Raghavendra Rao illustrent la façon de contourner la censure de manière manifeste. Ajoutons enfin, pour ceux qui suivent de loin le cinéma indien, que les cinémas régionaux du sud sont généralement plus entreprenants lorsqu’il s’agit de choquer le spectateur que les films hindis très largement aseptisés produits à Bombay. Les films de genre du sud de l’Inde sont très souvent plus violents et bruts de décoffrage. Remarque d’autant plus importante que le cinéma de Bombay (a.k.a. Bollywood) est, de manière exclusive et regrettable, la vitrine du cinéma indien à l’étranger. A titre d’exemple, le film policier tamoul Vettaiyadu Vilaiyadu (2006) de Gotham Menon présente à nos chastes pupilles le corps nu d’un cadavre féminin délicieusement décomposé, flouté façon poils pubiens des A.V. japonais. Et, concernant la production disponible dans le sud et difficilement accessible en dehors des circuits purement indiens, il existe une multitude d’obscurs petits films sexy avec de courtes séquences érotico-soft (très très soft) dans lesquelles les acteurs sont en plein acte sexuel. Bon ok, ils gardent l’intégralité de leurs vêtements mais c’est déjà pas mal, le tout c’est d’y croire un minimum.
Afin d’illustrer ces timides incursions sur le thème de la sexualité, revenons sur 3 films proposant une approche totalement différente sur le sujet.
Mixed Doubles (2006) de Rajat Kapoor est une petite comédie de mœurs indienne, sur un sujet non conventionnel : l’échangisme ! Cette petite bouffée de fraîcheur au sein de la production aseptisée de Bombay narre les efforts d’un père de famille qui veut persuader sa femme de s’essayer à l’échangisme pour pimenter leur vie de couple. Jamais vulgaire, toujours drôle et un minimum moralisateur dans son final, Mixed Doubles ose provoquer de manière légère et s’émancipe astucieusement de bien des stéréotypes du cinéma indien.
Navarasa (2005) du Tamoul Santosh Sivan (The Terrorist et Asoka) traite de la caste des travestis dans une Inde puritaine et traditionaliste. Film d’auteur subtil, sincère, minimaliste et juste … Navarasa ose mettre en avant toute une population habituellement traumatisée par les tortures et la moquerie. La jeune fille interprétant Swetha incarne parfaitement cette Inde moderne qui ne demande qu’à évoluer et oublier toutes les traditions qui sont néfastes à l’épanouissement. Tourné dans le sud de l’Inde et alternant tamoul, hindi et anglais, Navarasa mérite plus qu’un succès d’estime car, malgré son cadre exotique et si lointain, il réagit face à un tabou universel.
Divine Temple – Khajurâho (2002) d’Ashok Kumar (attention aux homonymes !) est un film sexy se passant à proximité des fameux temples de Khajurâho. Toutes les occasions sont bonnes pour présenter les femmes dans des séquences bikinis ou saree wet à la fois osées mais bridées par l’autocensure. L’actrice principale est Mamta Kulkarni, connue pour avoir posé topless dans le magazine indien Startdust et s’être ainsi délibérément attiré les foudres des intégristes religieux. Une brève séquence de pré-baise habillée ultrasoft et ultracourte tente de provoquer un soupçon d’excitation avec une subversion somme toute relative.
Bien que les réalisateurs indiens tentent anecdotiquement la transgression, il en est tout autre concernant les cinéastes N.R.I. (Non Resident Indian, terme par lequel on désigne la diaspora indienne) qui ose traiter la sexualité de manière plus ou moins subtile. S’il y a deux noms à retenir, il s’agit des réalisatrices Mira Naïr (née en 1957 à Bhubaneshwar, elle navigue entre l’Inde et les USA) et Deepa Metha (née en 1950 à Amritsar, elle a émigré au Canada en 1973).
Mira Naïr se fait connaître en 1989, lorsque son Salaam Bombay ! remporte le prix du public et la Caméra d’Or à Cannes. 1996 marque un tournant en Inde puisque son film Kama Sutra : A Tale Of Love réussit, après une longue bataille face à la censure, à être diffusé en Inde. Dans l’Inde du XVIe siècle, Kama Sutra présente les aventures amoureuses d’une servante et d’une princesse (incarnées par des actrices de la diaspora). Malgré de lourdes maladresses dans la mise en scène, le pamphlet courageux de Mira Naïr offre de nombreuses séquences de nudité et d’érotisme rares. Un film étonnamment apprécié et respecté en Inde (toute proportion gardée) alors qu’il est une exception dans le paysage cinématographique indien moderne. Rappelons qu’il aura fallu attendre 2005 pour que le CBFC dirigé alors par l’ancienne actrice Sharmila Tagore, autorise les baisers à l’écran. Kama Sutra est aujourd’hui l’un des best-sellers des vendeurs de DVD.
Deepa Metha est, elle aussi, à l’origine d’un scandale concernant son film Fire, sorti en 1996. En effet, traiter l’homosexualité féminine en Inde reste un sujet fortement polémique. A l’inverse de Mira Naïr qui choque le spectateur en imposant la nudité et les rapports amoureux à l’écran, Deepa Metha joue sur la subtilité et la pudeur pour faire passer son message de tolérance et d’ouverture.
Alors que, à l’aube du deuxième millénaire, la bonne vieille VHS des familles limitait la diffusion facile et incontrôlable des œuvres cinématographiques, l’ère du numérique, de l’internet et du DVD semble alimenter de manière exponentielle toute une industrie pornographique jusqu’alors très marginale. Le desi porn désigne les films à caractère pornographique (allant du soft porn au film hardcore pur et dur) tournés par les Indiens expatriés et destinés aux Indiens de la diaspora ainsi que ceux du sous-continent qui savent maintenant où se procurer le précieux sésame. Le terme desi du sanskrit « desh » (littéralement patrie) signifie « compatriote ». Même si le phénomène n’est pas encore organisé comme peut être l’industrie cinématographique pornographique en occident, on retrouve maintenant des réalisateurs et des stars. Richard Menon, qui est l’un des pionniers dans le domaine, pense que l’Inde s’ouvre lentement dans l’industrie pornographique, qui est jusqu’ici illégale dans le pays. « Les choses sont en train de changer. On trouve en Inde Playboy, Debonair, et Royal Magazine vient de faire son apparition. On trouve également de nombreux sites indiens porno, tenus par des Indiens sur Internet. Je pense qu’un nouveau genre de films soft à caractère sexuel peut se développer à Bollywood si quelqu’un en prend la tête ». Richard Menon est à l’origine d’un documentaire très remarqué intitulé The Indian Playboy : Anatomy of a Porn Film et veut être l’une des figures de proue de ce nouveau phénomène en Inde. Un film comme Kalyug de Mohit Suri (2005), qui devait à l’origine s’intituler Blue Film, raconte le drame d’un couple qui a été victime à son insu de l’industrie du porno en Inde. Kalyug présente le côté obscur de ce business géré de l’étranger (Zurich en Suisse dans ce cas précis). À la fois racoleur dans sa démarche et moralisateur dans son message, Kalyug tente de présenter la façon dont l’industrie fonctionne, comment internet permet la diffusion incontrôlée des images incriminées et les dégâts qu’elles peuvent faire sur certains individus … avec comme toile de fond l’exploitation d’êtres humains et le fonctionnement mafieux de ces réseaux.
Tout semble s’accélérer dans le pays. Alors qu’il y a peu les revues érotiques vendues en Inde légalement ne disposaient d’aucunes photos, on peut retrouver aujourd’hui, avec Savita Bhabhi, la première BD pornographique présente sur la toile indienne (http://savitabhabhi.com). Savita est une femme mariée qui couche avec des inconnus pour tuer l’ennui provoqué par un mari absent la plupart du temps. Le site est mis à jour quotidiennement de manière illégale en Inde mais jouit d’une popularité croissante (plusieurs milliers de connexions par jour et plus de 30 000 abonnés) et les pages sont traduites dans les neuf langues nationales. Malgré l’anonymat des graphistes et la clandestinité néanmoins relative du site internet (de nombreuses plaintes ont déjà été déposées selon le ministère de l’Information et des Technologies), force est de constater que Savita Bhabhi répond à un désir à peine dissimulé qu’ont les Indiens, des classes moyennes pour l’essentiel, de s’affranchir d’une certaine hypocrisie moralisatrice. Comme dans tous les pays occidentaux, les moteurs de recherche sur internet sont principalement mobilisés dans le ciblage de sites pornographiques.
Largement marginal pour le moment dans la production annuelle indienne, le sexe devrait prendre une part de plus en plus importante dans le paysage cinématographique indien. L’accès aux sites internet aux contenus explicites et le piratage de plus en plus agressif devraient permettre des libertés jusque-là insoupçonnées. La seule inconnue réside principalement dans la propension qu’auront, à l’avenir, les réalisateurs mainstream à défier la morale des spectateurs, ainsi que celle de la CBFC. Le cinéma reste en effet, en Inde, la principale source de divertissement des familles les plus modestes.


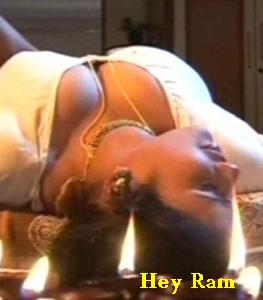



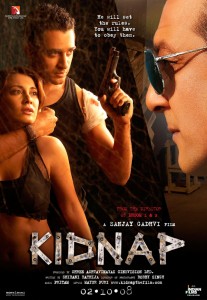
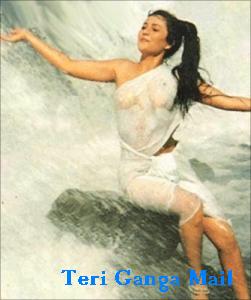



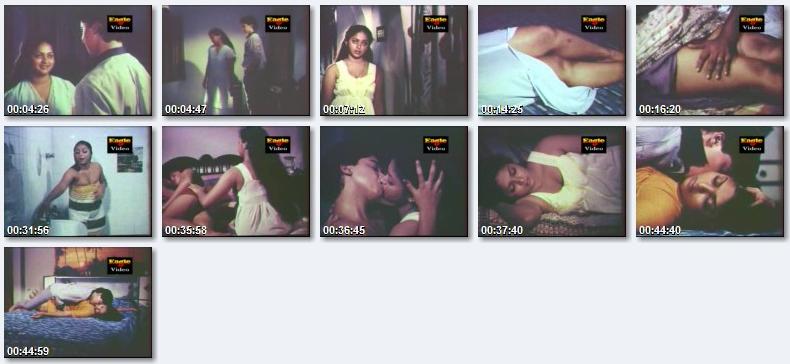
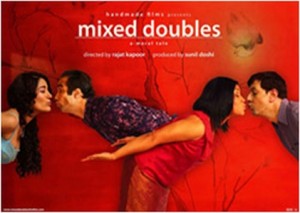

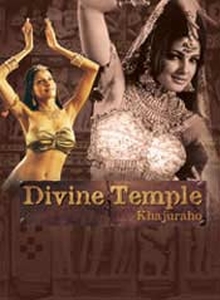
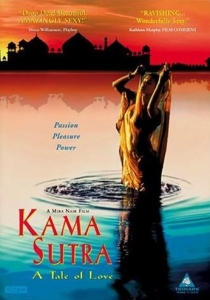
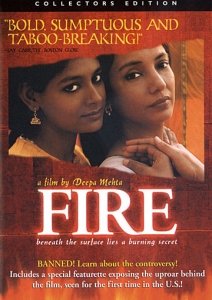



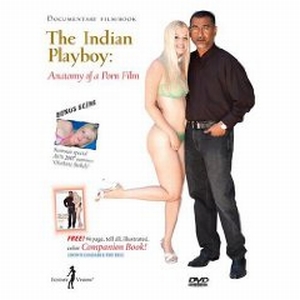









![[JV] Ghostwire: Tokyo (2022 – Playstation 5)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/03/Ghostwire_-Tokyo_20250113082822-680x340.jpg)
![[Film] Cinderella’s Curse, de Louisa Warren (2024)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/04/vlcsnap-2025-04-13-07h40m38s071-680x340.png)
![[Dossier] Survival Horror Partie 3, le retour du retour de la revanche](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2024/12/Rickdonnie_Pathologic2_20200206_19-53-56-680x340.png)
![[Interview] Mickaël Dusa et Jolan Nihilo (réalisateurs)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2023/11/Mickael-Dusa-Jolan-Nihilo-680x340.jpg)




![[Film] Six Assassins, de Jeong Chang-Hwa (1971)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/04/sixassassins-680x340.jpg)
![[News] Les Sorties Spectrum Films d’Avril](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2024/09/Spectrum-Logo.jpg)
![[Film] Curbing Violence, de Qin Peng-Fei (2024)](https://www.darksidereviews.com/wp-content/uploads/2025/03/curbingviolence-680x340.jpg)